
Les graffitis, on les adore, ou on les déteste! Leur seule mention énerve déjà une partie des gens, non sans raison. Le nettoyage des bâtiments, trains et autres surfaces qui ont été tagués à la bombe ou gravé HBVGs à l’aide d’objets entraîne des coûts annuels de plusieurs millions. Du coup, beaucoup de gens n’y voient que du vandalisme et d’autres les associent aux gangs. Or certains témoins les considèrent aussi comme de l’art à part entière. En parlant de graffiti, personne ne penserait au… 19ème siècle. C’est pourtant à cette époque que l’un des premiers graffeurs a sévi! Armé certes de peinture à l’huile et non d’un spray, mais quand même. Joseph Kyselak n’était pas un ado rebelle, mais un type tout à fait dans la norme: un fonctionnaire de la cour à Vienne. Il avait parié qu’en trois ans, il serait connu dans toute la monarchie. Il a ainsi voyagé et inscrit son nom de famille
partout. Lorsqu’il a fini par taguer un bâtiment impérial, l’empereur autrichien Franz Joseph I est sorti de ses gonds et a convoqué le barbouilleur. Ce dernier aurait promis de ne plus recommencer, mais la légende veut que l’empereur ait ensuite retrouvé le mot Kyselak gravé sur son bureau, quel culot! Le premier graffiti serait-il donc l’œuvre d’un quidam deux siècles plus tôt? Pas tout à fait. Selon la définition, les peintures rupestres peuvent également être considérées comme telles, si l’on s’en tient à l’ancienne signification du terme. Graffiti est le pluriel du mot italien graffito. Au
départ, ce terme désignait une inscription ou un dessin gravé dans la pierre. Il a toutefois évolué au fil du temps et est associé aujourd’hui à toute image apposée illégalement dans l’espace public.
Le mouvement actuel trouve son origine dans le Philadelphie des années 1960. Au cœur de l’histoire, on trouve Cornbread. Rien à voir avec du pain, c’était le pseudo de Darryl McCray, un ado qui, en 1967, voulait impressionner une fille. Il a donc inscrit son pseudo un peu partout dans la ville: sur des véhicules de police, des bâtiments, et même… un éléphant du zoo. A New York, c’est un livreur grec du nom de Dimitaki qui, lors de ses tournées, laissait son emblème Taki183 aux quatre coins de la cité. Lorsque le New York Times a révélé son manège en 1971, il a fait le buzz! Chacun était tenté de l’imiter et d’immortaliser son nom à la peinture. Dans les années 1970, le graffiti est devenu partie intégrante de la culture hip-hop. Aujourd’hui encore, le concept reste le même: taguer son nom le plus souvent possible, de la manière la plus stylée possible ou dans les endroits les plus insolites possibles. Pour quoi faire dans le fond? Pour le frisson et la «célébrité».
Dans le jargon du graffiti, on appelle bombing le fait d’apposer le plus rapidement possible un graffiti sur un mur. Par conséquent, les pieces créées sont généralement assez minimalistes, avec peu de peinture. On mise sur la quantité de dessins plus que sur leur qualité.
Contrairement au simple tag, on appelle pieces les œuvres élaborées, en principe multicolores, et qui s’étendent sur une grande surface. Depuis, le terme s’est aussi imposé pour désigner plus généralement un graffiti. L’essentiel est qu’il ne soit pas wack, c’est-à-dire vraiment mauvais. Aucun writer ne veut être qualifié ainsi, lui ou son œuvre.

Dans le jargon, ce terme fait référence aux tags sur les trains. Wholecar désigne un wagon qui a été peint sur toute sa longueur et toute sa hauteur avec un piece. Pareil pour un wholetrain, sauf que là on parle du train dans son ensemble, et pas juste d’un wagon.
Lors de la réalisation d’un tag, le sprayeur, appelé writer dans le milieu, appose son pseudo sur les murs et sur d’autres éléments urbains. Comme c’est généralement illégal, la plupart utilisent des sigles fictifs. Comme pour le bombing, le tag est avant tout une question de quantité. Le writer veut laisser son empreinte dans le plus grand nombre d’endroits insolites possible.
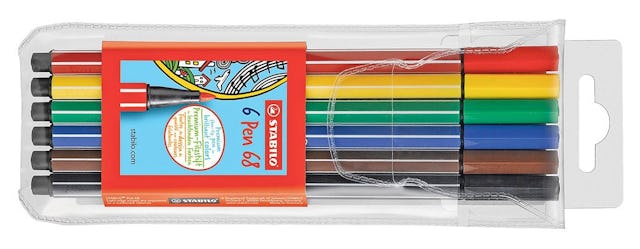
Aux États-Unis, le concept existe depuis les années 1930. Contrairement au stylewriting, qui met l’accent sur le style, les ganggraffiti marquent le territoire d’un gang. Si quelqu’un recouvre le logo d’un gang ennemi ou tague sur le territoire d’un autre, ça craint. Avec les ultras du graffiti, on est un peu dans le même genre qu’avec les ultras du foot: le style importe peu, l’essentiel est d’être visible.
As-tu déjà remarqué que les graffitis sont nettement plus nombreux le long des voies ferrées à l’entrée des gares? La raison est toute simple: c’est un endroit parfait pour se défouler. Cette succession de pieces est appelée line. En Suisse, celle de Bâle est particulièrement célèbre.